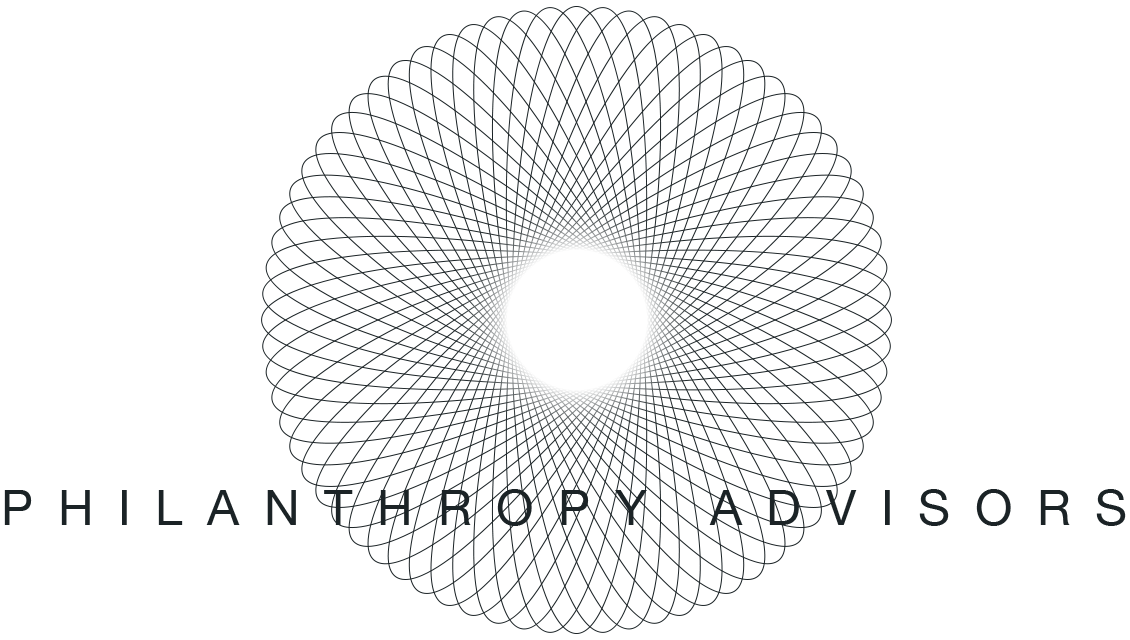Agent philanthropique, un métier d’avenir
December 11th, 2017 | LE TEMPS
Ils passent des zones de crise aux salons feutrés des grandes familles. Souvent issus du monde humanitaire, ces conseillers sont les garants de l’impact de la générosité.
Par Sylvain Besson
LE TEMPS, jeudi 12 octobre 2017 – Réalisé avec la collaboration du MONDE
Cela ressemble à un job de rêve. Sillonner le monde à la rescousse des populations les plus démunies, d’un côté. Fréquenter les super-riches de l’autre, à Paris, Monaco ou Saint-Moritz, en Suisse, pour mettre leur fortune au service de l’humanité.
De fait, le conseiller en philanthropie est devenu un acteur indispensable de l’industrie globale du don. « On se voit comme des accompagnateurs », résume Werner Blatter, un Suisse qui navigue entre ses clients en Europe et leurs projets en Asie centrale ou en Afrique.
Première étape de son travail : consulter les membres de la famille donatrice pour « faire surgir un thème sur lequel tout le monde est d’accord », explique cet ancien de l’Office des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui a créé le cabinet Social Investors en 2005. Ensuite, identifier les acteurs locaux qui vont concrétiser le projet.
Au Kirghizistan, Werner Blatter a convaincu une famille de financer les salaires de psychologues, de juristes et d’animateurs d’une maison d’accueil pour femmes battues. Avec des visites annuelles sur place, sa société mesure les performances et la gestion financière du projet, un impératif dans la philanthropie d’aujourd’hui.
Franc-parler
Au départ, le conseiller en philanthropie vient du monde feutré des family offices, ces bureaux qui gèrent le patrimoine des grandes fortunes. En Europe, c’est au début des années 2000 qu’apparaît le conseiller indépendant. Etienne Eichenberger, ancien du World Economic Forum et de la fondation suisse Schmidheiny, a été un précurseur. Il constate que « l’information circule mal, que beaucoup de gens sont mal ou pas assez conseillés. La philanthropie avait besoin d’expertise spécifique ». Encouragé par des banquiers genevois et luxembourgeois, il lance avec son associé, Maurice Machenbaum, le cabinet WISE en 2004 à Genève.
Sur le même modèle, des bureaux de conseil ont essaimé en France avec Prophil (Virginie Seghers) ou L’Initiative philanthropique (Jérôme Kohler). « Le secteur en France est très jeune et a encore un peu de mal à se déployer », malgré une politique de déductions fiscales généreuse pour les donateurs, observe Kristina Vayda, conseillère en philanthropie indépendante à Paris. Mais la demande devrait augmenter d’ici deux à cinq ans, à mesure que les fortunes des baby-boomeurs se transmettent à la prochaine génération, désireuse de moderniser leur philanthropie familiale.
Plus proches du terrain
Aujourd’hui, le secteur recrute de plus en plus d’humanitaires de terrain. A l’image d’Eric Berseth, un Suisse installé en France dont les petits bureaux parisiens sont constellés de Post-it et de cartes de zones de crise. Plutôt élégant avec ses vestes ornées de pochettes à pois, le trentenaire a sillonné les pays les plus dangereux de la planète (Afghanistan, Soudan, Haïti, Congo…) pour le compte de Médecins sans frontières et du CICR.
Selon lui, la mauvaise gestion de l’aide lors du séisme en Haïti, en 2010, ou du tsunami asiatique de 2004 – avec leur bousculade d’humanitaires, leur débauche de matériels inutiles, leurs montants engloutis par les intermédiaires – a poussé les donateurs à se rapprocher du terrain. « Aujourd’hui, pour avoir un impact maximum, on veut se faire accompagner par un prestataire compétent, mais opérationnel et de petite taille », explique Eric Berseth, qui précise que cela a un coût.
En plus de l’expérience des pays du Sud, ces nouveaux conseillers apportent un franc-parler rafraîchissant. « Etre proche du terrain permet de se rendre compte des dangers de l’assistanat et de comprendre le contexte pour ajuster une intervention », souligne Pascale de la Frégonnière, qui ‐ dirige la fondation Cartier Philanthropy à Genève.
Dans certains pays, comme Haïti, la densité d’ONG étrangères est telle que les communautés locales peuvent être tentées de laisser les projets d’aide se succéder, dans un cycle sans fin. « Parfois, les conditions sur place ne sont pas là pour que le projet continue sans injection soutenue de fonds venus de l’extérieur, poursuit-elle. Il faut en être conscient et mesurer le rapport entre le coût et l’impact pour prendre les bonnes décisions », y compris celle d’arrêter le projet.
Selon elle, le secteur souffre encore d’une culture de l’échec insuffisante : « On a le droit de se tromper. Mais il faut en faire l’analyse pour comprendre comment s’améliorer. Il faut arrêter de donner à ce qui ne marche pas ! »
Quel est le profil idéal pour faire ce métier ? Un diplôme dans le domaine du développement, du management ou du droit est recommandé. Tout comme une expérience professionnelle dans le secteur public, associatif, humanitaire ou les agences onusiennes.
« Il faut être au courant de l’actualité, capable de comprendre vite un domaine particulier, et réceptif aux buts et à l’approche du donateur », résume Donzelina Barroso, qui dirige le bureau londonien du cabinet Rockefeller Philanthropy Advisors à New York. Il faut aussi être à l’aise avec les riches philanthropes et leur univers. « On doit à la fois comprendre le secteur caritatif, et être à l’aise dans le monde des grandes familles et des entreprises, conclut Anna-Marie Harling, vice-chef de l’unité de conseil en philanthropie chez UBS. C’est un profil rare. »
Original article on LE TEMPS